Éditions L'Age d'Homme
septembre 2000
ISBN 2-8251-1411-1
[épuisé]
Livre 2001 de la Fondation Schiller Suisse
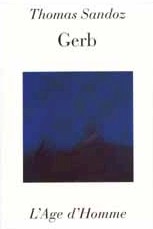
« On m'appelle Gerb et je suis inutile. Rien d'autre qu'un estomac cerclé de langes. »
Couverture : Maurice Frey, Sans titre, 1995
(Collection privée)
Pascal Helle, à propos de "Gerb", 24 Heures, 8 mai 2001
Thomas Sandoz qui s'était révélé brillant analyste des enquêtes de l'inspecteur Derrick [...], fin portraitiste d'écrivains de sa famille (Les Sandoz, Editions Gilles Attinger) confirme avec ce roman ce qui faisait le charme de sa chronique épistémologique dans les quotidiens neuchâtelois: la vigueur d'une plume qui laisse augurer de nouveaux textes aussi divers que les intérêts de leur auteur.
Le ton est donné, seul registre, peut-être, capable d'assumer sur plus de cent pages le thème choisi, faisant alterner l'atroce et le tendre sans atteindre à l'intolérable. Rien de plus et rien de moins que ce constat calme et lucide de l'horreur de vivre, qui débouche parfois inopinément sur la poésie […]»
Catherine Dubuis, Ecritures, n°57, printemps 2001
Noir. L'enfant.
On m'appelle Gerb et je suis inutile. Rien d'autre qu'un estomac cerclé de langes. A longueur de journée, je bave sur mon t-shirt de coton bleu. C'est ainsi, je n'y peux rien, personne ne peut rien pour moi. Au printemps prochain, cela fera dix-huit années que je me moisis dans un univers insipide et terne, dix-huit ans dont neuf enfermé au bunker des Mimosas, centre de traitement tout de béton et de néons spécialement conçu pour gérer les déchets de mon genre. Une fête sera organisée en mon honneur. Il y aura des gâteaux secs, des ballons, peut-être quelques cadeaux achetés le matin même. Il faudra en déchirer les papiers glacés pour moi car je n'ai ni bras ni jambes. En lieu et place, quatre moignons d'un demi-centimètre. A ma naissance, des morceaux de doigts terminaient ces boutefas. Les chirurgiens les ont trouvés encombrants et en ont pris soin aussitôt. Depuis, je joue à l'homme tronc dans un monde qui se rit de moi, espérant pourrir enfin.
[...]
Rose. Maman.
Maman n'avait pas vingt ans quand j'ai été conçu. Elle ne m'attendait pas et je fus la plus grande déception de sa vie. Peut-être pour conjurer le sort qui la maltraitait, elle a choisi d'exister à cent à l'heure. Les années soixante battaient leur plein. Elle venait de rencontrer mon père légal, un client du commerce de ses parents. A voir leur album de photos, ils ont dû être terriblement heureux, un de ces bonheurs si intenses que chaque jour est un risque de désenchantement.
Ils avaient bu tous deux. Qui conduisait, personne n'a jamais voulu le savoir. L'accident en soi fut bénin. Maman souffrait de légères contusions et mon père alla chercher secours sans se soucier de son bras meurtri contre la vitre de la portière. Très banalement, et très préventivement, ma mère fut nourrie de cachets grisâtres. Ce n'est qu'à ma naissance que leur toxicité apparut. Il était bien trop tard. Maman jura de me tuer. Elle n'y parvint malheureusement pas et chargea les institutions sanitaires de me faire crever peu à peu. Peut-être par simple contrariété, peut-être par esprit de vengeance.
Maman ne vient jamais au bunker. M'accueillir un week-end par mois, comme le règlement l'y contraint, lui suffit. Des séjours tellement espacés qu'ils lui donnent le sentiment de m'avoir élevé. Tous les malentendus de son quotidien me sont attribués. Il est vrai que sitôt mon premier cri éructé dans la salle d'accouchement, mes dissonances n'ont cessé de se répercuter sur ses émois. Elle a escompté me nier, mais sa mémoire ne s'est pas laissé discipliner. Elle s'est appliquée à s'inventer un nouveau passé, mais à chaque aube, il lui fallait reprendre ses improvisations. Jusqu'à l'épuisement.
La honte et la tristesse habitaient tant maman qu'elle s'est persuadée que chacun se retournait sur son passage, surtout lorsqu'elle poussait seule mon landau. J'étais trop présent, trop pesant, trop bruyant. Elle s'est remise le jour de mes neuf ans. Désormais apte à la vie d'internat, j'ai été gommé de son agenda. En une demi-matinée, elle a modifié l'étiquette de la boîte aux lettres, averti les voisins de mon départ et résilié une liasse de contrats d'assurances complémentaires. La même semaine, elle a fait repeindre son appartement et a jeté mes rares jouets décoratifs dans une valise. Il ne restait de moi que le contenu d'un tiroir de commode, soit quelques linges de corps moites de naphtaline.
Il suffit d'écouter nos mères pour se persuader de notre singularité. Elles ne sourient guère, sont moins pressées d'agiter leurs doigts devant nos visages, d'essuyer les larmes de nos terreurs. Elles flânent peu, s'enferment dans leurs hésitations. Dans les supermarchés, nos mères ne craignent pas que nous soyons volés puis dépecés pour alimenter un quelconque trafic d'organes. Nos couffins restent alignés près des portes principales, gardés par de vieux chiens de retraités. Mais parce qu'on les a autrefois admirés, ces toutous aux poils déteints ont souvent bien plus de valeur que nos dérisoires carcasses. Nous n'avons pas de lunettes de soleil, pas de chapeaux, pas de bonnet à revers, pas de bottines imperméables, juste parfois des gants en tricot pour cacher nos extrémités difformes. Il faut veiller aux dépenses sans avenir pour des êtres déjà fragiles. Habillés avec la plus stricte décence, nous traversons ainsi les saisons, sans surprise. Et si nos vêtements sont tellement tannés, c'est simplement parce que nous grandissons trop lentement.
[...]